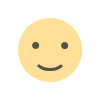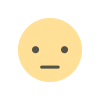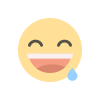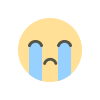les effets de la reconnaisance des jugements etrangers
Une décision étrangère ne peut certainement pas produire de plein droit tous ses effets, et nul ne le conteste : on voit mal la force publique se soumettre aux ordres émanant directement d’une autorité étrangère. Mais on ne peut pas pour autant lui dénier toute valeur propre, car alors on n’aurait plus besoin de poser le problème de l’effet des jugements étrangers : il n’y aurait dans un pays donné, comme source de droits dans les relations internationales, que les jugements nationaux. Or, l’indépendance des systèmes juridiques nationaux n’étant que relative, le droit positif n’a pu méconnaitre le fait qu’un jugement étranger existe, même si le juge de l’exequatur n’est pas (ou pas encore) intervenu.

Une décision étrangère ne peut certainement pas produire de plein droit tous ses effets, et nul ne le conteste : on voit mal la force publique se soumettre aux ordres émanant directement d’une autorité étrangère. Mais on ne peut pas pour autant lui dénier toute valeur propre, car alors on n’aurait plus besoin de poser le problème de l’effet des jugements étrangers : il n’y aurait dans un pays donné, comme source de droits dans les relations internationales, que les jugements nationaux. Or, l’indépendance des systèmes juridiques nationaux n’étant que relative, le droit positif n’a pu méconnaitre le fait qu’un jugement étranger existe, même si le juge de l’exequatur n’est pas (ou pas encore) intervenu.
En droit judiciaire français, l’on reconnait traditionnellement à ses jugements la force exécutoire, l’autorité de la chose jugée, la force probante et la déclaration ou l’attribution de droits.
On s’accorde à l’heure actuelle à reconnaitre aux décisions étrangères, quelles qu’elles soient, non seulement des effets en tant que fait juridique, mais encore une certaine force probante et un effet de titre. Les jugements d’état et de capacité se sont vu attribuer une efficacité supérieure : l’autorité de chose jugée que l’on dénie à l’heure actuelle aux autres jugements. La force exécutoire est unanimement refusée aux décisions étrangères, seul l’exequatur étant susceptible de la leur conférer.
Quels sont alors parmi ces effets, ceux qu’une décision étrangère peut produire de plano, indépendamment de toute intervention du pays d’importation ? Quelle est la valeur intrinsèque d’un jugement étranger ?
A – De l’autorité de la chose jugée et de la force exécutoire
Traditionnellement on a cru distinguer l’autorité de la chose jugée de la force exécutoire. La première serait conférée si le jugement étranger a satisfait aux conditions de régularité ; autrement dit, replacé dans son contexte étranger, le jugement parait inattaquable. A ce titre, il est revêtu, mais dans le pays d’origine, de l’autorité de la chose jugée.
Il n’est pas nécessaire de remonter à la théorie générale de l’exequatur ni aux raisons qui ont imposé un examen préalable, révision ou simple contrôle, de la décision étrangère. L’autorité de la chose jugée est conférée par un juge étranger, elle ne s’impose pas par le juge qui a rendu la décision. C’est pourquoi l’autorité n’est pas détachable du juge qui l’a conférée.
Il n’y a pas de raison de distinguer entre la force exécutoire et l’autorité de la chose jugée[1]. On ne voit pas quelle est la différence entre le défendeur qui oppose comme titre libératoire un jugement rendu à l’étranger, et le demandeur qui présente comme titre de créance une décision également étrangère. Comment concevoir que l’on puisse permettre au plaideur d’opposer un jugement étranger en compensation, alors qu’il doit recourir à l’exequatur pour en obtenir l’exécution directe.
L’autorité de la chose jugée « n’est qu’une des deux formes par lesquelles se manifeste l’imperium de l’Etat. L’une, d’ordre immédiat, est la force exécutoire par laquelle la puissance publique assure à celui qui a obtenu une décision de pouvoir la faire exécuter de force s’il y a lieu. Mais il y a une autre force obligatoire des décisions, force indirecte si l’on veut, ou médiate, mais force tout de même, c’est de faire respecter une décision et d’interdire qu’on la remette en discussion »[2]. Interdiction de remettre en cause ce qui a été jugé à l’étranger, obligation de mettre à la disposition du juge étranger la force locale d’exécution, ne sont que deux aspects d’une même réalité : la nécessité de se plier devant la décision du juge étranger[3]. Il est tout aussi normal d’exiger l’intervention du juge de l’exequatur qui procèdera à un contrôle préalable dans l’un et l’autre cas.
Il semble, en conséquence, difficile de distinguer les deux notions par leur nature. Les seules différences résideraient davantage dans leurs effets, leurs buts et la date à laquelle elles prennent respectivement naissance. Il est plus aisé de dire à quoi servent ces deux notions plutôt que ce qu’elles sont. Or, on peut répondre en disant que l’une constate, l’autre met en œuvre. Ce sont précisément les deux attributs essentiels du jugement, dont l’un constate ou crée, et l’autre met en œuvre ; le second dépend justement du premier et vient après lui.
Autorité de chose jugée et force exécutoire ne sont que les deux fonctions d’une même notion. En effet, le jugement est un titre, donc instrument de preuve et source génératrice de droit ; il est d’autre part un acte. On voit donc que le jugement réunit plusieurs aspects, mais qu’il doit à la fonction de la chose jugée[4].
Aussi, pour que le jugement soit un titre exécutoire, il faut qu’il soit devenu irrévocable, c’est-à-dire qu’il soit doté pleinement de cette autorité objet de discussion.
Le problème de l’autorité des jugements étrangers, du moins ceux relatifs à l’état et à la capacité des personnes, sera posé par l’arrêt de Wrède de 1900[5]. A partir de cette décision, de tels jugements seront réputés avoir en France autorité de plein droit. Mais la jurisprudence fait souvent appel aux anciennes notions de force probante et de juste titre. Ce n’est qu’en 1945 que la Cour de cassation déclare formellement que les décisions étrangères d’état sont pourvues de l’autorité de la chose jugée. Elle prend soin de préciser, cependant, que ces décisions doivent satisfaire à un certain nombre de conditions, relatives notamment à la compétence du juge qui a statué et à l’ordre public.
Après avoir longtemps résisté à la doctrine et à quelques décisions des juridictions inférieures, et parmi celles-ci surtout la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation, avec l’arrêt Munzer[6], a pratiquement étendu à tous les jugements étrangers le privilège dont, jusque-là, ne bénéficiaient que les jugements relatifs à l’état et à la capacité des personnes.
L’arrêt Munzer[7], qui est l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle, décide que « pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à savoir :
- La compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision ;
- La régularité de la procédure suivie devant cette juridiction ;
- L’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflits ;
- La conformité à l’ordre public international ;
- L’absence de toute fraude à la loi ; que cette vérification, objet même de l’institution de l’exequatur, constitue en toute matière à la fois l’expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge chargé de rendre exécutoire une décision étrangère, sans que ce juge doive procéder à une révision au fond de la décision ».
Le juge qui applique sa propre loi voit la décision qu’il rend, une fois devenue définitive, dotée d’une autorité automatique, dont l’un des attributs essentiels est le caractère exécutoire. Passé la frontière, ce jugement n’a plus ces caractères, du moins la force exécutoire.
Mais que deviendrait l’une sans l’autre ? La force exécutoire est le corollaire nécessaire, et d’ailleurs automatique, de l’autorité de la chose jugée. Un jugement se caractérise par ses attributs, fractionner ceux-ci, c’est le vider de son sens. C’est le lien intime entre l’un et l’autre de ces attributs qui a gêné la jurisprudence et la doctrine. Elles hésitent à conférer l’un lorsqu’elles savent que la décision étrangère ne sera probablement pas revêtue de l’autre.
Autorité et force exécutoire sont pratiquement difficiles à séparer. Il n’y a donc pas lieu de dissocier l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Toutes les deux conduisent au même résultat, et obéissent nécessairement aux mêmes conditions.
Le jugement marocain d’exequatur, à titre d’exemple, organise et ordonne l’exécution conformément à la loi marocaine, à la date de l’obtention de l’exequatur. La décision étrangère rendue en matière de dettes revêtue de l’exequatur par les tribunaux marocains peut être exécutée par voie de contrainte par corps.
La finalité de l’exequatur est de conférer la force exécutoire, au Maroc, à un jugement étranger. Rendu au nom d’une souveraineté étrangère, ce jugement en est dépourvu au Maroc. Mais cette force exécutoire qui lui est conférée par l’exequatur est nécessairement celle qui est organisée par la loi du pays où l’exécution aura lieu, c'est-à-dire la loi française, sans interférence de la loi du pays étranger d’où provient le jugement.
Il résulte de ceci que les voies d’exécution sont celles du droit marocain, et que parallèlement l’exécution provisoire ne peut être accordée que dans les conditions de la loi Marocaine.
De même, la prescription qui court à la suite du jugement revêtu de l’exequatur est celle du droit français, c'est-à-dire en principe un délai de trente ans.
Il reste toutefois à déterminer l’objet de cette force exécutoire du jugement étranger. On peut dire qu’elle ne s’étend pas au-delà de ce qui a été jugé à l’étranger.
La jurisprudence rejette en effet les demandes additionnelles qui seraient formulées en marge de l’exequatur. Si un jugement de divorce est présenté à l’exequatur dans le système Français, le demandeur ne peut joindre une demande additionnelle, comme le défendeur ne peut formuler une demande reconventionnelle, relative par exemple à la révision de la pension alimentaire accordée par le jugement étranger ou à la modification des mesures de garde des enfants mineurs. Il est nécessaire, alors, de saisir une juridiction française au fond pour obtenir satisfaction[8]. A l’inverse, il est possible de prononcer l’exequatur partiel, lorsqu’une partie du dispositif est contraire à l’ordre public[9], alors que l’autre partie est conforme à l’ordre public[10].
Si le juge de l’exequatur, ou la cour d’appel sur recours, rejettent la demande d’exequatur, la décision marocaine a l’autorité de la chose jugée entre les parties, de sorte qu’elle interdit toute nouvelle demande d’exequatur. Le jugement étranger se trouve alors radicalement privé d’effet au Maroc, si bien qu’une nouvelle demande au fond peut être formulée devant les juridictions Marocaine.
Ce même jugement Marocain d’exequatur confère l’autorité de chose jugée aux jugements étrangers, au regard des parties à l’instance dans la procédure d’exequatur.[11] L’autorité du dispositif du jugement étranger dépend ainsi du jugement Marocain d’exequatur.
L’autorité de chose jugée existe à dater du jugement Marocain accordant l’exequatur. De telle sorte que l’autorité du jugement étranger ne pourra être invoquée au Maroc qu’après l’octroi de l’exequatur. Mais cette autorité pourrait-elle être revendiquée avec effet rétroactif, dès le prononcé à l’étranger du jugement. La jurisprudence française paraît divisée. En principe, l’autorité de chose jugée étant conférée par le jugement français d’exequatur, celui-ci ne devrait pas produire d’effet rétroactif. Cependant, la Cour de cassation a jugé qu’un jugement étranger de condamnation à une pension alimentaire peut être invoqué après l’exequatur, pour les termes échus et impayés antérieurement à l’octroi de l’exequatur[12].
La Cour suprême a, dans son arrêt n°515 rendu le 13/09/2006 confirmé que : « …le jugement étranger produit ses effets à partir de la date où il a été rendu et non de celle de son exequatur ».
A noter que le jugement étranger bénéficie de l’autorité de la chose jugée avant même son exequatur conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et Contrats qui considère les jugements rendus par les tribunaux étrangers comme faisant foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires. La Cour suprême a adopté la même attitude dans ses arrêts en date du 27/09/2000, du 18/08/2000 et dans l’arrêt n° 452 rendu le 12/07/2006 qui a considéré que : « l’on peut se référer aux faits invoqués dans le jugement étranger dans l’action en divorce pour préjudice intentée devant la juridiction nationale ».
Selon l’article 24 de la convention bilatérale entre le Maroc et la France relative aux statuts personnels, contrairement à l’article 17 de la convention d’entraide judiciaire et d’exequatur du 05/10/1957, peuvent être publiés et inscrits dans les registres d’état civil sans qu’il y ait besoin de les revêtir de la formule exécutoire, les jugements ayant force de la chose jugée rendus en matière de statut des personnes.
B – De la force probante des jugements étrangers
En droit international privé, le refus d’une reconnaissance de plein droit de l’autorité de chose jugée aux jugements étrangers a conduit les auteurs et la jurisprudence française à se demander si on ne pouvait leur attribuer, à défaut, une certaine force probante. Mais que faut-il entendre par force probante du jugement, et quelle sera la force probante accordée aux décisions étrangères ?
Reconnaitre une force probante au jugement étranger c’est admettre, en dehors de toute question d’autorité de chose jugée ou de force exécutoire, qu’il puisse servir de moyen de preuve, soit dans une instance nouvelle, soit même dans le cadre de l’exequatur de ce même jugement.
De nombreuses décisions qui ont retenu la force probante d’un jugement étranger ont pris soin de souligner qu’il ne s’agissait pas pour autant de lui reconnaitre l’autorité de chose jugée. Il semble donc y avoir une différence de degré que de nature entre force probante et autorité de chose jugée, cette dernière constituant une présomption irréfragable de vérité, la première pouvant éventuellement se limiter à celle d’un simple témoignage, d’une présomption.
En parlant de force probante du jugement étranger, on songe à sa valeur en tant que moyen de preuve. Mais preuve de quoi ?
On distingue trois hypothèses[13] :
1 – Un tribunal peut intervenir dans certains cas à la manière d’un officier public, uniquement pour donner l’authenticité à un acte accompli devant lui. On peut songer à invoquer l’acte émané du tribunal comme preuve du fait juridique qui y est relaté, et de l’accomplissement des formalités nécessaires à sa validité. Mais dans ce cas, le juge n’a pas rendu à proprement parler une décision.
2 – Au cours d’un procès, le juge est amené à constater certaines choses qu’il a lui-même vues ou entendues, et qu’il reproduira dans son jugement. Le jugement étranger pourrait, comme tout acte authentique, faire foi de ces constatations, telles qu’aveux, témoignages, existence d’une convention antérieure non contestée. Ce ne serait pas consacrer l’œuvre du juge étranger, puisque celui-ci n’a pas tranché sur ces questions mais n’a fait que les constater.
On passe à un domaine différent lorsqu’on prend en considération la décision du juge sur un fait contesté.
3- Le juge ne se borne pas à constater des faits qui se sont déroulés devant lui et que personne ne conteste. Son rôle essentiel est de trancher des litiges, de rendre une décision sur des points controversés. On parle également de force probante du jugement étranger lorsqu’on entend se prévaloir en France, par exemple, de ce qu’il a décidé.
La majorité de la doctrine suivie en partie par la jurisprudence, françaises, a accordé aux jugements étrangers, en dehors de tout exequatur, une certaine efficacité qu’elle a rattachée à l’idée de force probante.
Perroud[14] se refuse à reconnaitre force probante au jugement étranger non revêtu de l’exequatur : « il peut constater les faits, apprécier des intentions, doser une responsabilité. Mais sur tous ces points il constitue une simple affirmation dont les tribunaux français tiendront tel compte qu’ils croiront devoir ». La solution est selon lui identique, qu’il s’agisse des formalités accomplies devant le tribunal ou des faits passés devant lui, tels qu’aveux ou déclarations des parties.
De l’absence de valeur probatoire, cet auteur déduit que la décision étrangère ne déplace même pas le fardeau de la preuve. L’ensemble de la doctrine admet, au contraire, qu’une décision étrangère puisse servir de moyen de preuve. Mais les divergences naissent lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de force probante.
Francescakis [15] fait nettement la distinction entre la force probante et ce qu’il appelle l’effet de titre : dans le premier cas, on utilise le jugement étranger en tant qu’instrument faisant preuve des actes intervenus au cours du procès ; dans le deuxième cas, il s’agit de se prévaloir du jugement étranger comme élément de preuve des droits qu’il déclare ou constitue. Pour la force probante proprement dite, le jugement étranger jouerait le rôle d’un acte public qui aurait pleine force probante dès lors qu’il émanerait d’un tribunal compétent ; au contraire, en ce qui concerne la preuve des droits dont elle décide, la décision étrangère n’aurait que la valeur d’une présomption simple, le juge gardant son entière liberté d’appréciation.
Batiffol[16] a une conception large de la notion de force probante : « la force probante d’un écrit est déterminée par la loi du lieu où cet écrit a été rédigé, et on étend la règle des actes privés aux actes authentiques. Il est donc permis de donner à un jugement étranger la valeur probante que lui reconnait la loi sous l’empire de laquelle il a été rendu, sans lui conférer pour autant l’autorité de chose jugée ». Mais s’il en déduit que le jugement étranger fera foi du contenu des pièces qu’il cite, des témoignages qu’il relève, il estime que les conclusions que le juge étranger en a tirées ne s’imposeront pas au juge français : le jugement étranger n’a que la valeur d’un témoignage laissé à la libre appréciation des tribunaux. Malgré cela, M. Batiffol, s’appuyant sur une jurisprudence qui devient de plus en plus fournie, attribue au jugement étranger en dehors de cette première hypothèse la valeur d’un titre, et s’explique sur ce qu’il entend par le mot titre : « instrument exposant des moyens de preuve sans qu’on préjuge de leur valeur ». Grâce à cet effet de titre, un jugement étranger suffira pour produire à une faillite, le syndic conservant néanmoins la faculté d’en contester la valeur ; il permettra également de pratiquer une saisie-arrêt sans autorisation du juge, sous réserve d’un débat dans l’instance en validité sur la valeur du titre ainsi évoqué, et de l’obtention de l’exequatur avant le jugement de validité. Mais la conséquence la plus importante de cette valeur de titre reconnue au jugement étranger réside dans la possibilité pour le bénéficiaire d’une décision étrangère de s’en prévaloir à l’appui d’une action nouvelle en France ayant le même objet. Mais le jugement étranger n’ayant pas autorité de chose jugée, le juge conservera un pouvoir d’appréciation[17].
Niboyet[18] quant à lui a posé et résolu la question en termes clairs. Pour lui la force probante est un effet découlant de la notion d’efficacité internationale des droits. Lorsqu’une personne entend se prévaloir d’un droit résultant d’une décision étrangère et que son adversaire lui conteste ce droit, la première, à défaut de pouvoir invoquer l’autorité de la chose jugée, ne triomphera que si elle obtient gain de cause dans une action principale, au cours de laquelle elle invoquera la décision étrangère comme titre justificatif de son droit.
Mais quelle sera alors la valeur de cette décision étrangère, sa force probante ? Niboyet distingue deux catégories de jugements : ceux qui ne tranchent aucune contestation et ceux qui tranchent une contestation.
Pour la première catégorie de jugements un parallèle peut être fait avec les actes publics : émanant d’une autorité publique, il n’y a pas de raison pour qu’ils vaillent moins qu’un acte fait par un notaire ou un officier public. Ils feront donc preuve de leur contenu, ils constitueront ce que Niboyet appelle un titre[19]. Pour cet auteur l’effet de titre peut se manifester dans des domaines très divers.
Un jugement étranger peut constituer un titre translatif de propriété, dès lors que d’après la loi du pays où il a été rendu il pouvait transférer la propriété, et l’a effectivement fait. C’est le cas d’un jugement d’adjudication de biens meubles ou immeubles situés dans le lieu de l’adjudication : si les biens viennent à être déplacés en France, par exemple, le bénéficiaire du jugement d’adjudication étranger justifiera de sa qualité d’adjudicataire par la seule production de la décision étrangère. La raison en est que le jugement d’adjudication ne tranche aucune contestation, mais constate seulement l’enchère qui a été portée, en vertu de quoi le plus fort enchérisseur a été déclaré propriétaire : le jugement a ici toute valeur en tant que titre translatif.
Il n’en va pas de même pour la deuxième catégorie de jugements : ceux qui tranchent une contestation. On passe ici au domaine proprement juridictionnel : le juge ne joue pas seulement le rôle d’un officier public chargé de constater certains faits, mais agit véritablement en juge, car il rend une décision sur un point controversé. Si la partie à qui on oppose une décision étrangère s’y soumet volontairement, la force probante produira ses effets ; mais si elle n’entend pas s’y conformer, la seule force probante sera insuffisante à l’y contraindre. Cela parce que le juge étranger a donné son avis personnel sur la question, et ne s’est pas contenté de contester des faits ou des actes qui se sont déroulés devant lui.
Pour les jugements tranchant une contestation, la force probante n’aura sa place et ne jouera un rôle qu’en cas d’accord des intéressés ; dès qu’il y a une contestation, la force probante devient insuffisante, et ce sont les notions d’autorité de chose jugée et de force exécutoire qui, seules, permettront de triompher de cette résistance.
[1] En ce sens : PERROUD, Répertoire, t. V, v° déc. Jud. Etr., n°53, p. 362 ; PILLET, Traité, t. II, n° 682, pp. 614, 617 à 619 ; BARTIN, Principes, t. I, § 190, pp. 487 et s. ; NIBOYET, Traité, t. VI bis, p. 73 ; LACOSTE, De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative n° 1433, p.542.
[2] NIBOYET, Traité, t. VI bis, p. 73, n° 682.
[3] PILLET, Traité, t. II, p. 618, n° 682.
[4] M. LE BALLE, « Cours de droit civil approfondi ; la chose jugée », cours de doctorat, Paris, 1954-1955 (ronéotypé), p. 308 et s.
[5] Arrêt de la Chambre civile du 9 mai 19—qui semble avoir inauguré cette jurisprudence ; il s’agissait de l’effet en France d’une décision étrangère d’annulation de mariage.
[6] Munzer c/ dame Munzer, Cas. Civ. 7 janvier 1964, J.C.P. 1964.13590, note Ancel ; Clunet 1964.302, note Goldman ; Rev. Cr. 1964.344, note Batiffol ; Rev. Tr. Dr. Com., 1964, n°2, p. 455, note Loussouarn. Cette jurisprudence, qui interdit la révision au fond, a été confirmée depuis. V Cas. Civ. 24 nov. 1965, Rev. Cr. 1966.289, note P. Lagarde ; Bull. Civ. 1965 1, p. 490, n° 645. V. aussi T.G.I. Troyes, 15 nov. 1963, Crédit Lyonnais c/ dame Tête, Vve Nastorg et autres, G.P. numéro du 24 nov.1967.
[7] Il s’agit de deux jugements américains dont la dame Munzer demandait l’exequatur en France. Le premier rendu en 1926, prononcait la séparation de corps entre les époux Munzer et allouait à la femme une pension alimentaire. Le second prononcé en 1958, condamnait Munzer à payer à son ex-épouse l’arriéré de la pension depuis 1930. La Cour d’appel, se fondant sur la jurisprudence traditionnelle en matière de jugements d’état et de capacité, acceuillit la demande d’exequatur, mais refusa d’examiner au fond la situation comme le lui demandait Munzer, c’est-à-dire de réviser la pension alimentaire mise à sa charge et qu’il estimait trop lourde.
[8] Civ. 1re, 18 déc. 1979 ; Civ.1re, 19 mars 199.
[9] Par exemple celle qui concerne la garde des enfants.
[10] Par exemple celle qui concerne le principe de dissolution du mariage.
[11] Serge GUINCHARD, Frédérique FERRAND, Procédure civile, Droit interne et communautaire, Précis DALLOZ, 2006 P, « 1071, 1090 ».
[12] P.MAYER et V .HEUZE, Droit international privé, MONTCHRESTIEN, Précis DOMAT, 2004.
[13] Cf. note AUDINET sous Civ., 30 janvier 1912, S., 1916.I.113.
[14] Répertoire, t. V, v° déc. Jud. Etr,. n° 205.
[15] Encycl. D. pr. Civ., v° jugement étranger, n° 23 à 34.
[16] Traité, 4e éd., n° 74 s., p. 842.
[17] Pour les jugements d’état qui se voient reconnaitre de plein droit autorité de chose jugée sous réserve d’un contrôle a posteriori de leur régularité, le juge français saisi d’une instance nouvelle doit nécessairement en tenir compte après vérification de la régularité internationale.
[18] Traité, t. VI bis, n° 1918 et s.
[19] Les auteurs n’ont pas tous donné le même sens au mot titre.
What's Your Reaction?